Université
Montpellier 3
Département d’Espagnol
ES2B6M
Littérature et Civilisation de l’Espagne médiévale
Responsable de l’enseignement :
Pr. Carlos Heusch
Présentation
Cet ECUE est une initiation à l’Espagne médiévale, à travers la Civilisation et la Littérature. En ce qui concerne la Civilisation, il permet à l’apprenant de se familiariser avec les spécificités médiévales de la péninsule Ibérique, comme l’existence sur le sol ibérique d’une multiplicité de royaumes (et donc d’États), mais également l’incontournable pluralité culturelle, mêlant christianisme, judaïsme et, surtout, Islam, qui, si elle est loin de constituer un modèle de tolérance, reste une exception dans le contexte de l’occident médiéval expliquant, de ce fait, certaines particularités des chrétiens d’Espagne ayant puisé dans cette pluralité, même de manière forcée. En outre, la connaissance de cette période fondatrice des États et des communautés espagnols permettra à l’apprenant de mieux comprendre les spécificités de l’Espagne du présent : notamment, la nécessité d’un État fondé sur les Communautés autonomes ; mais aussi l’ancrage dans un lointain passé de la pluralité linguistique espagnole et le fait que la suprématie quantitative du castillan n’est que la conséquence de la suprématie politique d’un ancien comté, d’abord sous la houlette du royaume de Léon, qui saura tirer son épingle du jeu de la Reconquête au point d’être au xve siècle la première puissance de la péninsule Ibérique.
En ce qui concerne la littérature, le choix s’est porté sur une œuvre spécialement significative des formes littéraires de la Castille médiévale et qui, en même temps, renvoyait à des questions historiques traitées dans le cours de Civilisation. En effet, Juan Manuel, n’est pas seulement un écrivain, il est l’un des aristocrates les plus influents de son temps et, à ce titre, ces écrits deviennent souvent le reflet des conflits et des réalités de cette époque charnière qu’est le début du xive siècle, où l’influence orientale est encore très présente mais où la nouvelle société chrétienne et castillane issue de la Reconquête se dessine déjà avec force. En outre, El Conde Lucanor est le meilleur exemple du genre littéraire le plus fécond du xiiie siècle à la première moitié du xve siècle : le didactisme. Or, cette œuvre trouve son originalité dans le fait d’avoir su organiser de façon cohérente toutes les formes du discours didactique : de l’exemplum jusqu’à la prose doctrinale, en passant par les recueils de sentences. L’étude suivie de cette œuvre constitue donc une très bonne première approche de la littérature médiévale castillane, tant en amont qu’en aval. Elle s’avère également le meilleur moyen de se familiariser avec la langue médiévale que l’étudiant d’espagnol est censé connaître, parallèlement, à travers les cours de linguistique diachronique.
Pour éviter les pertes de temps inutiles il est fondamental que l’étudiant puisse se procurer dans les meilleurs délais l’œuvre à étudier dans l’édition proposée ci-contre et, surtout, qu’il puisse effectuer avant même le début du cours une première lecture approfondie, crayon en main. Certes, la langue médiévale espagnole est bien plus proche de l’espagnol moderne que ne l’est l’ancien français du français actuel ; certes, l’édition proposée est celle qui offre le plus de notes linguistiques facilitant la lecture ; il n’en demeure pas moins que s’agissant d’un texte ancien, au même titre que les œuvres du siècle d’Or, cette lecture ne saurait s’improviser ou s’effectuer à la légère. Je rappelle qu’en principe tout ce qui ne fait pas l’objet d’une note en bas de page dans l’édition proposée peut être trouvé dans le Diccionario de la Lengua Española (Madrid, Real Academia Española / Espasa Calpe, 1992) dont la possession par l’étudiant s’avère indispensable à ce niveau d’études.
BIBLIOGRAPHIE
SUR JUAN MANUEL
Édition utilisée pour le cours :
Don Juan Manuel, El Conde Lucanor. Edición de Guillermo Serés.
Colección “Clásicos y modernos”, num. 9. Barcelona : Editorial Crítica,
2001, ISBN 84-8432-174-6 [version économique] ou bien : edición de
Guillermo Serés. Colección “Biblioteca Clásica”, núm. 6. Barcelona :
Editorial Crítica, 1994 (ISBN : 84-7423-709-2) [version chère mais bien
plus complète].
Traductions :
Don Juan Manuel, El Conde Lucanor, ed. modernizada de E. Moreno Báez, Odres Nuevos,
1, Madrid: Castalia, 1998, ISBN 84-7039-024-4;
Don Juan Manuel, Le livre du Comte Lucanor, trad. de M. Garcia, Paris : Aubier, 1995, ISBN 2700716620.
Études :
Ayerbe-Chaux (Reinaldo), “El Conde Lucanor”. Materia tradicional y originalidad creadora.
Madrid: Porrúa Turanzas, 1975;
Devoto (Daniel), introducción al estudio de Don Juan Manuel y en particular de “El Conde
Lucanor”: una bibliografía. Madrid: Castalia, 1972;
Diz Marta Ana, Patronio y Lucanor. La lectura
inteligente ‘en el tiempo que es turbio’. Potomac (Maryland, USA): Scripta
Humanistica, 1984;
Flory (David A.), Don Juan Manuel en su
contexto histórico. Madrid: Editorial Pliegos, 1995;
Gómez Redondo (Fernando), La prosa del siglo XIV, in R. de la Fuente, Historia de la literatura española 7, Madrid - Gijón: Ed. Júcar,
1994 (ISBN 84-334-8409-5);
Gómez Redondo (Fernando), Historia de la prosa medieval castellana I: La creación del
discurso prosístico, Madrid: Cátedra, 1998;
Lacarra (M.J.) y López Estrada (F.), Orígenes de la prosa, in R. de la
Fuente, Historia de la literatura
española 4, Madrid - Gijón: Ed. Júcar, 1993, ISBN 84-334-8405-2.
Narrativa
breve medieval románica.
Ed. de J. Montoya, A. Juárez, J. Paredes, Granada: Impredisur, 1991;
Romera Castillo (José), Estudios
sobre ‘El conde Lucanor’. Serie Minor, 1. Madrid: U.N.E.D. – Depto de
Filología Hispánica, 1980.
Présentation de Juan Manuel
 et de
et de
El
Conde Lucanor
Dans le Libro enfenido (le Livre inachevé), une des dernières œuvres de Juan Manuel, rédigée vers 1344 et adressée à son fils Ferdinand, on peut lire :
Et commo quier que yo se que algunos profaçan de
mi por que fago libros, digo vos que por eso non lo dexare, ca quiero crer al exienplo que yo pus en
el Libro que yo fiz de Patronio, en que dize que
Por dicho de las gentes,
sol que non sea mal,
al pro tened las mientes
et non fagades al.
Et pues en los libros que yo fago ay en ellos pro et verdat et non danno,
por ende non lo quiero dexar por dicho de ninguno. Et los que dello profaçaran,
quando ellos fizieren su pro et bieren que fago yo mi danno, estonçe deven ser
creydos que fago lo que me non cae de fazer libro. Ca devedes saber que todas
las cosas que los grandes sennores fazen, todas deven ser guardando
primeramente su estado et su onra, mas esto guardando, quanto mas an en si de
vondades, tanto son mas conplidos. Ca bien cred que grant bien es al grant
sennor quando son contadas las sus vondades, et grant su mal es quando son
contadas las sus tachas. Et pues yo tengo que maguer en mi aya muchas
menguas, que aun fasta aqui non he fecho cosa porque se mengüe mi estado, et
pienso que es mejor pasar el tienpo en fazer libros que en jugar los dados o
fazer otras viles cosas[1] (je souligne).
Traduisons le début et la fin : « Et quoique je sache que d’aucuns médisent de moi parce que je fais des livres, je vous dis que ce n’est pas pour cela que je cesserai d’en faire ». Et, plus loin : « Et donc, je pense que, même si j’ai maints défauts, jusque-là je n’ai jamais rien fait au détriment de ma condition. Je crois, en outre, que mieux vaut passer son temps à écrire des livres qu’à jouer aux dés ou faire d’autres vilaines choses ». Un tel aveu fait tout d’abord état d’un terrible paradoxe qui n’a jamais abandonné notre auteur. Celui de se consacrer à une activité qui ne devait pas être la sienne, faire des livres. Dans le partage médiéval des groupes sociaux et leurs activités, c’est-à-dire le schéma tripartite qui était déjà acquis – et peut-être même caduc – dans la Castille du xive siècle, puisque Juan Manuel en parle dans son Livre des états (ch. 92)[2], dans ce partage, dis-je, il revient aux uns de défendre par les armes le royaume, aux autres de produire ce qui est nécessaire à la vie, et à d’autres, enfin, de prier pour le salut des âmes de tous : bellatores, laboratores et oratores. Selon ce même schéma, seuls ces derniers sont censés frayer avec les livres, par la lecture mais aussi par l’écriture. Or qui est Juan Manuel? Un des plus grands seigneurs de son temps; prince de sang, chevalier et même gouverneur de province, donc chef d’une grande armée. Un bellator convaincu. Qu’est-ce qui a pu le pousser à avoir des goûts étrangers à son appartenance sociale, tels la lecture, et, plus grave encore, qu’est-ce qui a pu le pousser à s’adonner à des activités qui empiétaient carrément sur les domaines professionnels des autres, telles l’écriture ? On comprend donc les médisances, des médisances qui devaient venir aussi bien de ceux qui s’étonnaient de voir un des leurs jouer les « intellectuels » que de ceux qui tenaient au caractère « professionnel » de la culture et du savoir. Car il faut bien se rendre compte que la chose pouvait paraître aussi paradoxale d’un côté que de l’autre.
Cela nous permet de comprendre une certaine conscience d’illégitimité créatrice qui traverse l’œuvre de Juan Manuel, y compris dans ses dernières productions. On peut s’étonner que l’auteur ait encore à se justifier, comme dans le texte cité plus haut, après avoir composé des œuvres de l’importance du Libro de los Estados et du Conde Lucanor! Cette justification on la retrouve, sous différentes formes, dans la plupart des pièces liminaires (prologues généraux et prologues de partie) qui accompagnent les œuvres de Juan Manuel. Certes, parfois elle s’apparente tout à fait à un topique rhétorique fort répandu au moyen âge, celui de la « modestie affectée »[3]. Cependant, Juan Manuel en fait un usage si personnel, il est si impliqué subjectivement dans cette modestie, que celle-ci va nécessairement au-delà d’une simple captatio benevolentiae, c’est-à-dire de la traditionnelle volonté de s’assurer la bienveillance du lecteur. Modestie et illégitimité créatrice peuvent donc être des choses différentes, comme on le voit, d’ailleurs, dans le Prologue général de Juan Manuel à l’ensemble de toutes ses œuvres :
... lo que fallaren que es y menguado, non pongan culpa ala mi entencion,
ca Dios sabe buena la ove, mas ponganla a la mengua de mi entendimiento, que
erró en dos cosas: la una, en el yerro que y fallaren, et la otra, porque fue
atrevido a me entremeter en fablar en tales materias entendiendo la mengua del
mio entendimiento et sabiendo tan poco de las scripturas (fin du Prologo
general)[4].
Ces deux erreurs concernent la modestie d’un côté mais l’illégitimité de l’autre. Ce dédoublement de la simple captatio est repris de manière constante, comme, par exemple, dans le Libro de los Estados, d’abord dans le Prologue (ch. 2):
Et porque yo entiendo que segunt la mengua del mio entendimiento et del mio
saber, que es grant atrevimiento o mengua de seso de entremeterme yo a fablar
en tan altas cosas, por ende non me atrevi yo a publicar este libro fasta que
lo vos viésedes (éd. cit., p. 73)
Soulignons au passage que Juan Manuel s’adresse à son beau-frère, Jean d’Aragón, fils du roi Jacques, donc prince de sang comme Juan Manuel, mais qui occupe, lui, un rôle d’orator dans la société : il s’agit, en effet, de l’archevêque de Tolède. Cet autre « Juan », a pu être perçu par Juan Manuel lui-même comme une espèce d’alter ego intellectuel fantasmé, étant donné, d’ailleurs, qu’il a été un des rares amis authentiques de notre auteur, comme il le suggère à la fin du Libro enfenido, dans un petit traité consacré à l’amitié. En outre, quand la voix de Juan Manuel se fait entendre à nouveau dans le livre qui nous occupe, dans le Prologue de la 2e partie, c’est pour insister avec plus de force encore sur cette idée :
É que es mas manera de atrevimiento que de buen recabdo encomençar yo tan
grant obra commo lo que se entiende en este libro
On remarquera l’importance de la première personne dans toutes ces citations. Cette auto-inculpation qui sert, en fait, d’auto-exculpation est une constante dans l’œuvre manuéline. Ainsi, notre Lucanor n’est pas une exception. L’avant-prologue (anteprólogo) reprend avec une étonnante fidélité les idées du Prologue général, et par conséquent cette « exculpation » de l’activité littéraire de Juan Manuel :
... por las menguas que en ellos [los libros de Juan Manuel] fallaren, non
pongan la culpa a la su entencion, mas ponganla a la mengua del su
entendimiento, porque se atrevio a sse entremeter a fablar en tales cosas (p.
46).
Un peu plus loin, cet avant-prologue développe une autre idée, variation sur le même sujet, qui est l’utilisation de la langue vulgaire et non pas du latin, signe non seulement que l’œuvre est écrite pour un public de « non-spécialistes » (ceux qui ne sont pas oratores) mais que l’auteur lui-même est un non-spécialiste :
Et por ende fizo todos los sus libros en romançe, et esto es señal çierto
que los fizo para los legos et de non muy grand saber commo lo el es (p. 47)
Je ne pense pas, pour de multiples raisons, que cet avant-prologue ait été écrit par Juan Manuel lui-même. Cela dit, peu importe, puisqu’il reprend des idées que notre auteur expose un peu partout dans son œuvre.
Paradoxe, donc, d’un auteur, sans doute pour nous le plus grand auteur, le plus grand « faiseur de livres » du xive siècle castillan, qui a eu sans cesse à justifier ses activités littéraires puisque de telles activités ne relevaient pas de sa condition sociale, de son « état », pour reprendre le terme que Juan Manuel lui-même utilise. En effet, ce clivage, cette position quelque peu en porte-à-faux, ont dû nécessairement être ressentis de manière assez oppressante par quelqu’un comme Juan Manuel qui a tenu à consacrer un ouvrage entier aux différences entre les « états », certes dans une perspective essentiellement eschatologique. Mais cette situation initiale est peut-être l’une des clés qui nous permettent de comprendre, ou tout du moins d’expliquer, le génie littéraire de notre auteur. Ce paradoxe est, en fait, riche d’une immense liberté de création. Ne parlant au nom de personne et selon la perspective de personne, mais au nom de lui-même et selon sa perspective personnelle, Juan Manuel n’est prisonnier d’aucune rhétorique de groupe. Certes des influences sont appréciables : les thématiques abordées dans ses écrits ont une configuration sociale bien déterminée (celle de l’aristocratie militaire), de même que l’idéologie dominicaine transparaît à chacune de ses affirmations d’ordre spirituel. Mais ce sont juste des influences qui ne sauraient enfermer ou limiter ni la pensée ni l’expression littéraire. Juan Manuel est donc un écrivain essentiellement hétéroclite : on le voit au choix de ses sources, mais aussi à la liberté avec laquelle il exploite ses sujets. Cela est d’une grande importance pour comprendre, par exemple, l’œuvre qui nous intéresse, le Conde Lucanor. L’originalité avec laquelle Juan Manuel travaille sur le matériau littéraire pré-existant dans les recueils à usage homilétique est la preuve irréfutable des distances qu’il peut prendre par rapport à ce qui serait un usage « professionnel » des exempla des prédicateurs, c’est-à-dire l’ordre des dominicains qu’il mettait au-dessus de tous les autres. Cela nous fait arriver à une affirmation que l’on peut exprimer sous forme de boutade : c’est parce que Juan Manuel n’aurait jamais dû écrire qu’il a pu écrire si librement, autrement dit, qu’il a pu écrire d’une manière aussi fabuleusement moderne, au point de fasciner un Jorge Luis Borges (je songe, mais nous y reviendrons, à l’inquiétant exemple 11, celui de « Don Yllán »). Un paradoxe en entraîne donc un autre et ainsi de suite.
Pourquoi ce paradoxe d’une écriture qu’il fallait justifier d’un bout à l’autre? Permettez-moi de l’expliquer par un nouveau paradoxe. En fait, j’ai l’impression que Juan Manuel ne se justifie jamais qu’à l’intention des autres. Il me semble que la chose ne devait avoir pour lui rien de singulier. Dans le for intérieur de Juan Manuel, nouveau paradoxe, vous allez voir, c’est sans doute sa position sociale qui a pu justifier son écriture. Il ne se considère en aucun cas un bellator comme un autre. Il existe, comme on dirait aujourd’hui en Espagne, un « fait différentiel » manuélin fondamental, qui le distingue radicalement des autres nobles. Il a, d’ailleurs, consacré un livre entier à cette question, la question de la « différence » des Manuel, de cette lignée dont Juan Manuel a eu l’intuition qu’il en était la pièce maîtresse, c’est-à-dire à la fois récepteur et donateur d’héritage. L’Histoire lui donnera raison de cette intuition : Juan Manuel, fils de Manuel, l’Infant éponyme; père de Juana Manuel, reine de Castille et de Constance Manuel, reine du Portugal. Mais, ne nous égarons pas, ce livre dont nous parlons, c’est le Livre des armes dont la finalité première est de situer la lignée manuéline par rapport à la royauté. Cela signifie qu’il est question de mettre en lumière idéologiquement l’identité première qui lie cette lignée à la royauté. C’est à cela que sert l’analyse des trois questions abordées dans ce petit traité : d’abord, la description sémantico-héraldique des armes données par Ferdinand III à l’Infant Manuel, à l’initiative de l’archevêque de Séville ‑ qui était, d’ailleurs, à l’origine du nom « Manuel » ‑ (des armes à quarterons comme celles des rois); deuxièmement, les raisons pour lesquelles les Manuel ont le droit d’armer des chevaliers sans être eux-mêmes chevaliers (prérogative exclusivement réservée aux monarques) et, troisièmement, les dernières paroles du roi Sanche IV in transito mortis , à la fois confession et testament symbolique, sous forme de bénédiction, en faveur de la lignée des Manuel, un discours qui, au vu des événements historiques que Juan Manuel ne connaîtra même pas a une valeur prophétique presque inquiétante. Bref, le Livre des armes tend à réaliser une assimilation symbolique des Manuel à la royauté. D’autres textes confirment une telle assimilation, par exemple un passage du Libro enfenido, le Livre inachevé, où il apparaît que, dans l’esprit de Juan Manuel, les Manuel sont une espèce de chaînon manquant entre la race des rois et celle des hommes (voir les chapitres 5 et 6, Obras completas, I, p. 161-163). Si on file une métaphore qui est chère à Juan Manuel, on pourrait même affirmer qu’à l’instar de la double nature du Christ, les Manuel sont des rois dans l’âme, mis dans des corps de simples hommes. Autant dire que Juan Manuel se considère ‑ et considère ceux de son lignage – comme un presque roi, ce qui, d’ailleurs, n’est pas loin de sa situation politique et sociale réelle. Il est seigneur de nombreux fiefs et places-fortes (tellement que, comme il le dit à son fils dans le Livre inachevé, celui-ci peut aller du royaume de Navarre à celui de Grenade sans coucher ailleurs que dans des villes et des châteaux appartenant aux Manuel, cf. ch. 6), pouvant, de ce fait, entretenir un millier de chevaliers; il est, en outre, pendant la minorité d’Alphonse XI, régent du royaume, et agit donc, pendant un certain temps, en souverain; il est, enfin, comme son père, adelantado mayor de la frontera et del regno de Murcia, donc sorte de gouverneur ou de vice-roi. Tout cela nous permet de comprendre ce fait assez inouï d’une activité politique qui a tout d’une politique royale. Ses interlocuteurs politiques sont directement les rois, qu’il s’agisse d’obtenir leur soutien, comme dans le cas du roi d’Aragon – son beau-père –, ou de leur déclarer une guerre ouverte, comme à Alphonse XI de Castille. Il faudra être attentif à l’influence qu’a pu avoir une telle position sociale et politique de Juan Manuel dans la configuration du personnage du Comte Lucanor qui est, comme nous le verrons, l’une des facettes de la double personnalité de Juan Manuel. Lucanor est l’alter ego du Juan Manuel « homme d’État », homme politique, si vous préférez, de même que Patronio l’est du Juan Manuel « sage », dispensateur de bons conseils (je précise cette idée car on insiste trop sur la relation entre Juan Manuel et Lucanor alors que, de mon point de vue, Juan Manuel se coule dans les deux personnages, ce que, d’ailleurs, est confirmé par le personnage de Julio dans le Livres des états).
Ce qui nous intéresse pour l’instant, c’est de bien remarquer que cette quasi-royauté de Juan Manuel lui confère la possibilité d’une responsabilité culturelle. Une occasion que notre auteur ne laisse pas passer. Car, en ce domaine il a à sa portée un modèle parfait à émuler, c’est celui de son oncle, le roi Alphonse X, dit el sabio, le « savant ». Or, Juan Manuel est très explicite sur l’admiration qu’il porte à son oncle. Elle est manifeste, par exemple, dans le Prologue de sa Crónica abreviada, une œuvre qui semble, en plus, avoir été composée de manière, disons, « royale », si on s’en tient à la définition qu’en donne la General Estoria, source du texte de Juan Manuel: « le roi fait un livre non pas parce qu’il l’écrit de ses propres mais, mais parce qu’il en trouve les mots et les corrige et indique la manière dont il faut les écrire de sorte qu’ils sont écrits par la personne à qui il a ordonné de le faire »[5] (le Prologo précise : « este libro que don Iohan […] mando fazer », O.C., II, p. 573 et, plus loin : « fizo poner en este libro en pocas razones », ibid., p. 576). On peut ainsi faire l’hypothèse que c’est cette quasi-royauté de Juan Manuel qui a pu lui fournir la conviction personnelle de sa légitimité littéraire.
Mais, inversement, une autre hypothèse s’impose : c’est par son activité littéraire que Juan Manuel a pu aussi souhaiter faire « œuvre de roi », montrant par là qu’il était, en quelque sorte, semblable à son oncle, lui enviant, sans doute, en secret, l’appellation de « roi sage ». Telle est la différence de Juan Manuel et, ainsi, des paradoxes se résolvent grâce à d’autres paradoxes. Car, Juan Manuel est un paradoxe et une contradiction vivants. Ce qui justifie, d’ailleurs, qu’on s’attarde, quelque peu, sur certains éléments marquants de sa biographie.
***
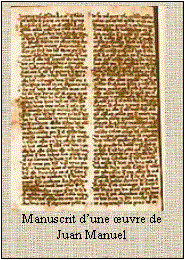 Si
j’ai dit que la vie même de Juan Manuel est un paradoxe, c’est parce que
celui-ci remonte à sa naissance. En fait, on peut dire que Juan Manuel est venu
au monde par hasard, ou plutôt au hasard d’un événement malheureux, la mort
d’Alphonse Manuel, premier fils de l’Infant Manuel. Alphonse X avait trouvé
pour son frère bien-aimé un parti honorable en la personne de la princesse
Constance, fille du roi Jacques Ier d’Aragon, dit « Le
Conquérant » ‑ né, rappelons-le, pour la circonstance, à
Montpellier. Constance lui donne deux enfants, Alphonse et Violante, mais meurt
en 1266. Bien évidemment, Manuel pouvait fort bien s’accommoder de ce veuvage
tant qu’il avait un héritier mâle. Or voilà que celui-ci disparaît tragiquement
en 1275. Il a donc fallu trouver en vitesse nouvelle épouse. Cet honneur
reviendra à une veuve italienne, la princesse Béatrice de Savoie. C’est ainsi
que Juan Manuel peut naître, dans un certain sens, rien que pour sauver
l’héritage de son père. Un père, d’ailleurs, relativement âgé qui mourra un an
après. Cela n’est pas sans importance car c’est ainsi que l’on peut expliquer,
d’une part l’obsession de Juan Manuel pour la notion d’héritage et, d’une
manière plus large, pour la conservation du rang, de l’« état » (conservar
el estado, que non se mengüe el estado) puisqu’il s’agit presque de
sa seule raison d’être en ce bas monde, et, d’autre part, la vénération portée
à ce père qu’il n’a pas connu et par rapport auquel il a toujours défini son
identité, de façon presque phantasmatique : … yo, don Johan, fijo del
Infante don Manuel. Cette formule reste la même dans tous les écrits de
Juan Manuel.
Si
j’ai dit que la vie même de Juan Manuel est un paradoxe, c’est parce que
celui-ci remonte à sa naissance. En fait, on peut dire que Juan Manuel est venu
au monde par hasard, ou plutôt au hasard d’un événement malheureux, la mort
d’Alphonse Manuel, premier fils de l’Infant Manuel. Alphonse X avait trouvé
pour son frère bien-aimé un parti honorable en la personne de la princesse
Constance, fille du roi Jacques Ier d’Aragon, dit « Le
Conquérant » ‑ né, rappelons-le, pour la circonstance, à
Montpellier. Constance lui donne deux enfants, Alphonse et Violante, mais meurt
en 1266. Bien évidemment, Manuel pouvait fort bien s’accommoder de ce veuvage
tant qu’il avait un héritier mâle. Or voilà que celui-ci disparaît tragiquement
en 1275. Il a donc fallu trouver en vitesse nouvelle épouse. Cet honneur
reviendra à une veuve italienne, la princesse Béatrice de Savoie. C’est ainsi
que Juan Manuel peut naître, dans un certain sens, rien que pour sauver
l’héritage de son père. Un père, d’ailleurs, relativement âgé qui mourra un an
après. Cela n’est pas sans importance car c’est ainsi que l’on peut expliquer,
d’une part l’obsession de Juan Manuel pour la notion d’héritage et, d’une
manière plus large, pour la conservation du rang, de l’« état » (conservar
el estado, que non se mengüe el estado) puisqu’il s’agit presque de
sa seule raison d’être en ce bas monde, et, d’autre part, la vénération portée
à ce père qu’il n’a pas connu et par rapport auquel il a toujours défini son
identité, de façon presque phantasmatique : … yo, don Johan, fijo del
Infante don Manuel. Cette formule reste la même dans tous les écrits de
Juan Manuel.
Il faut aussi bien voir que cet héritage et cet estado sont aussi de taille et qu’il n’est pas vraiment simple de s’en occuper. Cela oblige Juan Manuel à une activité qui nous mène à nouveau au personnage de Lucanor. Juan Manuel est contraint de pratiquer de manière constante une importante activité politique : s’entourer de bons conseillers pour conclure de bonnes alliances, faire de bons choix dans l’action et savoir déjouer les pièges que vous tendent adversaires et même amis présumés. Nul doute que de telles activités façonnent l’image réaliste et désabusée que se fait Juan Manuel du monde, image que nous tenterons d’analyser à travers son œuvre. Ces « dangers » du monde, Juan Manuel en a fait l’expérience surtout à la majorité d’Alphonse XI, le roi avec lequel il a eu les conflits politiques les plus graves et dont nous avons quelques traces indirectes dans le Lucanor. À sa majorité, Alphonse XI commence par écarter Juan Manuel de son conseil, alors que celui-ci avait été le régent du royaume. Pour faire avaler la pilule, le roi fait à Juan Manuel la promesse d’épouser sa fille Constance, mariage qui a lieu solennellement le 28 novembre 1325 à Valladolid. Constance Manuel est répudiée peu après (mais gardée en otage par le souverain) au bénéfice de la fille d’Alphonse IV, roi du Portugal. Curieusement, c’est avec le roi Pierre du Portugal que son père la mariera (encore un signe de l’étrange rapport psychologique que Juan Manuel entretenait avec les rois péninsulaires de son temps, tous ses « parents », selon le modèle du Cid, aussi bien en Castille, qu’en Aragon, qu’au Portugal). En tout cas, Juan Manuel a vécu la décision du roi Alphonse comme un véritable affront personnel, comme une nouvelle afrenta de Corpes. Mais, contrairement au Cid, il n’a pas cherché satisfaction dans le Droit mais sur le terrain de bataille, et c’est la guerre ouverte avec son ancien seigneur naturel de qui il se desnatura en bonne et due forme. Juan Manuel cherche l’appui du roi d’Aragon mais le soutien de ce dernier se refroidit quelque peu après être devenu le beau-frère du roi de Castille et avoir décidé de mener avec lui une offensive commune dans les territoires musulmans. Juan Manuel répond alors par son mariage avec Blanca Núñez de la Cerda, parti fort intéressant qui lui permettait de renouer avec une branche « royale », les La Cerda, descendants directs d’Alphonse X qui auraient dû d’ailleurs succéder à ce dernier s’il n’y avait pas eu le soulèvement de Sanche IV, et de conclure une alliance de parenté avec la famille des Lara, un des deux clans les plus puissants du royaume, avec leur rivaux, les Haro. Après des hostilités fort onéreuses et à l’issue incertaine le très réaliste Juan Manuel choisit de pactiser. Une première réconciliation politique arrive en 1329. Juan Manuel retrouve ses charges politiques, les adelantamientos, et, en 1333, Alphonse XI le gratifie même du titre de Prince de Villena. À cette époque, Juan Manuel développe une intense activité littéraire, dont notre Conde Lucanor, achevé en 1335. Il y a, juste après, de nouvelles hostilités avec Alphonse XI, de nouvelles démarches diplomatiques en Aragon, une nouvelle desnaturación, et une dernière réconciliation, définitive, cette fois-ci qui nous fait retrouver Juan Manuel aux côtés du roi de Castille lors de la bataille du Salado, en 1340. Il meurt en 1348 et est enterré dans son lieu de prédilection, Peñafiel, dans le Sagrado du monastère dominicain qu’il avait lui-même fondé.
On aura vite fait de comprendre avec ce petit résumé biographique ‑ que vous pourrez compléter en consultant les introductions des éditeurs des ouvrages de Juan Manuel ‑ que la vie de Juan Manuel a été source d’autant de satisfactions sociales et politiques que de frustrations. Être un « presque roi », en effet, a pu lui donner la satisfaction de la singularité, cette « différence » dont je parlais plus haut, un statut absolument hors-norme qui rendait possibles bien des choses, à commencer par une activité littéraire. Mais n’être que « presque roi », avoir à se contenter de cette proximité asymptotique avec le véritable exercice du pouvoir monarchique, n’est-ce pas l’image du plus cuisant des échecs? D’ailleurs, l’Histoire s’est chargée de réaliser avec ses descendants ce qu’il n’obtint jamais pour lui-même, se confondre avec la royauté. Mais cette destinée de son lignage lui échappe complètement, alors qu’elle lui appartient dans un certain sens, ne serait-ce qu’en raison de son caractère absolument paradoxal. Ces filles seront reines, mais de manière insoupçonnée : celle qui devait l’être de la Castille, le fut du Portugal, celle qui ne devait être que l’épouse d’un bâtard de prince castillan, Henri de Trastamare, se retrouva reine de Castille : son fils, contrairement à la coutume castillane, ne recevra pas le nom du grand-père paternel, mais maternel, Juan Manuel, et ce sera le roi Jean de Castille, premier de ce nom.
***
Juan Manuel, en tant qu’écrivain, a plusieurs choses en commun avec un autre auteur, son aîné de presque un siècle, Gonzalo de Berceo. Dans les deux cas, nous avons affaire à deux écrivains qui ont énoncé de manière claire et distincte leur qualité d’auteurs, leur identité, voire leur subjectivité créatrice. Or, Berceo est, en quelque sorte, l’équivalent poétique de Juan Manuel : si Berceo est le premier poète à nous avoir légué une production poétique en elle même cohérente, au point de former un tout qui est maintenant édité en un seul volume; Juan Manuel est le premier prosateur dont l’œuvre présente ces mêmes caractéristiques. Il faudrait donc réfléchir au lien qui semble unir conscience créatrice et volonté de faire œuvre chez nos deux auteurs. Toujours est-il que Juan Manuel nous a laissé une œuvre abondante aussi bien en extension qu’en diversité, et qu’il a été le premier à le faire en prose. Jusqu’à lui, en effet, on a, pour la plupart, des œuvres anonymes ou des traductions. Une seule exception, mais elle est tout à fait significative, celle d’Alphonse X, oncle de Juan Manuel, comme nous l’avons déjà dit, et qui est le seul à avoir aussi laissé une importante œuvre en prose avant notre auteur. Voilà, peut-être, un argument supplémentaire pour mettre en évidence le lien que nous avons suggéré plus haut entre « écriture » et « royauté » (ou quasi-royauté, dans le cas de Juan Manuel). Peut-être donc chez Juan Manuel écrire revient à sublimer ce pouvoir qu’il n’as pas eu. En tout état de cause, le caractère absolument singulier de cette œuvre mérite qu’on s’y attarde quelque peu.
Tout d’abord, il convient de signaler que Juan Manuel est assurément le premier auteur du moyen âge castillan préoccupé par la diffusion de ses œuvres, et, faut-il ajouter, par la bonne diffusion de celles-ci. On peut être surpris par l’importance qu’il accorde à cette question, tout particulièrement dans le fameux Prologo general. L’idée de réunir en un seul volume ses propres œuvres était déjà novatrice en soi, mais les raisons qui le poussent à le faire sont carrément surprenantes : Juan Manuel dit avoir voulu faire une « édition » (c’est le mot qu’il emploie) de référence, directement relue et corrigée par lui à laquelle pourront se rapporter tous ceux qui auront des doutes sur la fidélité des autres versions qu’ils auront consultées. En d’autres termes, il s’agit de la volonté de créer ce que dans le domaine du Droit — pratique, d’ailleurs, exclusive de ce domaine — on appelle un exemplar. Et ce parce que trop souvent, pense-t-il, on fait des reproches à l’auteur alors que c’est le copiste qu’il faut incriminer. De ce fait, Juan Manuel est un des premiers à bâtir des limites précises entre l’univers de la création littéraire et celui de sa reproduction, de sa diffusion, ou, pour reprendre une terminologie plus en accord avec le moyen âge, entre l’auctor et le scriptor. Souvenons-nous des querelles qui divisent les spécialistes pour savoir si le fameux Per Abat qui a eu le malheur d’apposer son nom à la fin du manuscrit du Poema de Mio Cid est l’auteur ou un simple copiste. Eh bien, cet exemple vous permet de mieux mesurer l’écart qui sépare ce genre de problématique de celle de Juan Manuel, cent et quelques années plus tard. Pour lui, il ne faut plus jamais confondre création et diffusion, auteur et « écrivant » : l’auteur doit se déclarer tel, dans sa plus grande subjectivité, et limiter aussi ses attributions. On ne s’étonnera pas, dès lors, de voir apparaître cette subjectivité d’auteur un peu partout à l’intérieur même des œuvres de Juan Manuel : Juan Manuel s’adonne avec délectation à une pratique ludico-littéraire qui, si elle est pratiquée par d’autres auteurs médiévaux, comme par exemple le majorquin Raymond Lulle ‑ avec qui Juan Manuel a bien des choses en commun ‑, atteint chez Juan Manuel un véritable paroxysme. C’est ce que j’appelle l’auto-autorité. On y reviendra.
Mais revenons à l’idée que se fait Juan Manuel de son œuvre et, en particulier, au soin avec lequel il cherche à figer la lettre-même de son œuvre, à sacraliser presque son « écriture ». Et j’emploie sciemment une terminologie empruntée à la religion, car il faut savoir que ce genre d’attitude face au texte n’avait de sens à l’époque que par rapport aux écritures sacrées (et, dans son versant technique, déjà indiqué, dans le Droit). Juan Manuel semble reproduire par son attitude à l’égard de sa propre création littéraire le fétichisme scripturaire de la patristique. Je vous laisse le soin de tirer des conclusions. Pour mieux ficeler la question, Juan Manuel ne se contente pas d’énoncer, platement l’idée qui nous occupe; se souvenant des bons conseils de ses amis les prédicateurs, il nous glisse même un exemplum pour que la chose reste à jamais gravée dans nos esprits. Le texte mérite qu’on le cite presque intégralement :
Asi commo ha muy grant plazer el que faze alguna
buena obra, sennalada mente siu toma grant trabajo en la fazer, quando sabe que
aquella su obra es muy loada et se pagan della mucho las gentes, bien asi ha
muy grant pesar et grant enojo quando alguno, a sabiendas o aun por yerro faze
o dize alguna cosa porque aquella obra non sea tan preciada o alabada commo
devia ser. Et por probar aquesto porne aqui una cosa que acaescio a un
caballero en Perpinan en tienpo del primero rey don Jaymes de Mallorcas.
Asi acaecio que aquel caballero era muy grant trobador et fazie muy buenas
cantigas a marabilla et fizo una muy buena ademas et avia muy buen son; et
atanto se pagavan las gentes de aquella cantiga que desde grant tienpo non
querian cantar otra cantiga si non aquella, et el cavallero que la fiziera avia
ende muy grant plazer. Et yendo por la calle un dia oyo que un çapatero estaua
diziendo aquella cantiga et dezia tan mal errada mente tan bien las palabras
como el son que todo omne que la oyesse si ante non la oyie ternia que era muy
mala cantiga et muy mal fecha. Quando el cavallero que la fiziera oyo commo
aquel çapatero confondia aquella tan buena obra commo el fiziera ovo ende muy
grant pesar et grant enojo et descendio de la bestia et asentose cerca del. Et
el çapatero que non se guardava de aquello, non dexo su cantar, et quanto mas
dezia, mas confondia la cantiga que el cavallero fiziera. Et desque el
cavallero vio su buena obra tan mal confondida por la torpedat de aquel
çapatero, tomo muy passo unas tiseras et tajo quantos çapatos el çapatero tenia
fechos; et esto fecho, cavalgo et fuesse. Et el çapatero paro mientes en sus
çapatos et desque los vido asi tajados et entendio que avia perdido todo su
trabajo, ovo grant pesar et fue dando voces en pos de aquel cavallero que
aquello le fiziera. Et el cavallero dixole :
‑ Amigo, el rey nuestro sennor es aqui et vos sabedes que es muy buen
rey et muy justiciero et vayamos antel et librelo commo fallare por derecho.
Anbos se acordaron a esto et desque legaron antel rey dixo el çapatero como
le tajara todos sus çapatos et le fiziera grant damno. El rey fue desto sannudo
et pregunto al cavallero si era aquello verdat et el cavallero dixole que si,
mas que quisiesse saber por que lo fiziera. Et mando el rey que lo dixiesse; et
el cavallero dixo que bien sabia el rey que el fiziera tal cantiga que era muy
buena et abia buen son, et que aquel çapatero gela avia confondida et que gela
mandasse dezir. Et el rey mandogela dezir et vio que era asi. Estonçe dixo el
cavallero que pues el çapatero confondiera tan buena obra como el fiziera et en
que avia tomado grant danpno et afan que asi confondiera el la obra del
çapatero. Et el rey et quantos lo oyeron tomaron desto grant plazer et rieron
ende mucho; et el rey mando al çapatero que nunca dixiesse aquella cantiga nin
confondiesse la buena obra del cavallero et pecho el rey el damno al çapatero
et mando al cavallero que non fiziesse mas enojo al çapatero.
Et recelando yo, don Johan, que por razon que non se podra escusar que los
libros que yo he fechos non se ayan de trasladar muchas vezes et porque yo he
visto que en el transladar acaeçe muchas vezes lo vno por desentendimiento del
escrivano o porque las letras semejan vnas a otras, que en trasladando el libro
porna una razon por otra en guisa que muda toda la entençion et toda la
sentencia et sera traydo el que la fizo non aviendo y culpa; et por guardar
esto quanto yo pudiere fizi traer este volumen en que estan escriptos todos los
libros que yo fasta aqui he fechos [...]
Et ruego a todos los que leyeren qual quier de los libros que yo fiz que si
fallaren alguna razon mal dicha que non pongan a mi la culpa fasta que bean
este volumen que yo mesmo concerte; et desque lo vieren, lo que fallaren que es
y menguado, non pongan la culpa a la mi entencion, ca Dios sabe buena la ove
[...]
Nous connaissons déjà la suite. Je pense que vous n’êtes pas sans voir, d’ailleurs, les immenses connexions qui existent entre ce texte et l’avant-prologue du Lucanor. Même le petit exemplum du savetier de Perpignan irait à merveille pour faire commencer notre Libro de los enxiemplos.
De nos jours, la chronologie des œuvres de Juan Manuel a pu enfin être établie avec un minimum de certitude. Hélas, elle ne concerne que les huit œuvres de notre auteur qui ont été conservées. En effet, l’édition que Juan Manuel avait lui-même préparée et corrigée et qui était, selon lui, l’édition de référence pour pallier les éventuelles déficiences des toutes les autres a disparu. Du coup, nous avons perdu le texte de six dont nous ne connaissons que le titre (à deux reprises Juan Manuel fournit des listes plus ou moins exhaustives de ses œuvres, dans le Prologo general et dans notre conde Lucanor) : Libro de los engeños, Libro de las cantigas, Libro de los sabios, Libro de la caballería, Crónica complida et les Reglas de trovar.
Les huit œuvres conservées sont les suivantes et selon cette chronologie :
Crónica abreviada,
avant 1326;
Libro de la caza,
avant 1326;
Libro del caballero et del escudero (c. 1327);
Libro de los estados
(ou del Infante), 1330;
Libro del Conde Lucanor, 1335;
Libro enfenido
(1342-44);
Libro de las armas,
1342;
Tractado de la asunción de la Virgen María, post 1342.
L’analyse de cette liste chronologique (qui, soit dit en passant, ne fait pas l’unanimité, je suis celle qui est proposée par Guillermo Serés, dans son édition du Lucanor) nous montre que l’on peut dégager trois étapes fondamentales dans la création littéraire de Juan Manuel. Il y aurait tout d’abord deux œuvres réalisées sous l’emprise des projets culturels d’Alphonse X. En effet, aussi bien la Cronica que le traité de chasse sont comme des prolongements d’œuvres du Roi Savant auxquelles, d’ailleurs, renvoie directement Juan Manuel. La deuxième étape, au cours de laquelle, notre auteur semble tendre vers une plus grande maturité intellectuelle et créatrice est à l’évidence caractérisée par le didactisme. Enfin, une dernière période – si l’on met à part l’ultime œuvre, à la thématique mariale – concerne davantage la problématique de ce que l’on pourrait appeler le « manuélisme » c’est-à-dire la reconnaissance de l’identité du lignage des Manuel, son importance, ses prérogatives, etc., et, surtout, l’utilisation de l’écriture pour assurer la transmission, l’héritage de cette identité.
Il apparaît donc que parmi ces huit œuvres il apparaît clairement que c’est le didactisme qui l’emporte. En effet, nul doute qu’il est quatre œuvres majeures, ou, plus exactement, trois plus une. Les trois grandes œuvres majeures sont Caballero, Estados et Lucanor. On peut ajouter à cette liste le Enfenido qui est un texte souvent oublié mais, au moins comparable au Caballero. Or ces quatre œuvres servent à illustrer le thème de la transmission d’un savoir formant ce que l’on peut appeler le corpus du didactisme manuélin. Les 2 premières incarnent le didactisme dialogique, voire maïeutique, la troisième le didactisme exemplaire et sapientiel, la 4e est une pédagogie. Il est, cependant, une différence fondamentale entre les trois premières et la dernière : même si le Livre infini peut être rapproché du didactisme en raison de son contenu et de la démarche pédagogique, il n’en demeure pas moins que cette œuvre se passe entièrement de tout recours à la fiction. Or c’est sans doute là que réside la caractéristique commune aux trois œuvres de la véritable périodique didactique de Juan Manuel (1327-1335) : il s’agit de fictions littéraires et, surtout, il s’agit des seules fictions littéraires – assumées, en tout cas, en tant que telles – de toute la production littéraire de Juan Manuel.
Libro del Caballero et del escudero
Cela commence par une petite mise en scène initiale, une petite histoire qui forme le cadre de ce dialogue didactique. Un écuyer rencontre un chevalier âgé et expérimenté qui a quitté le monde pour devenir ermite. On dit souvent que le dialogue porte sur la chevalerie, ne serait-ce que parce que la source dont s’est servi Juan Manuel est le Llibre qui es de l’ordre de cavalleria de Raymond Lulle. Mais en fait, il s’agit d’une vaste encyclopédie du monde chrétien : foisonnent les enseignements métaphysiques, moraux, et quelques digressions plus surprenantes comme celle sur la chasse au faucon.
Libro de los Estados
C’est le texte de loin le plus important de Juan Manuel avec le Lucanor. Il s’agit, en quelque sorte du prolongement du précédent. Là encore le poids didactique repose sur l’échange dialogique et sur la dialectique enseignant/enseigné. Mais la fabliella est ici déjà plus élaborée. On chemine davantage vers la fiction. La mise en scène n’est pourtant pas de Juan Manuel. Elle est tirée d’un ouvrage oriental dûment christianisé qui a connu un grand succès dans la Castille de l’époque, Barlaam e Josapahat (traduit en castillan en 1300). Dans la version de Juan Manuel, un jeune prince, nommé Johas, est tenu à l’écart des choses « négatives » du monde et tout particulièrement la vieillesse et la mort. Inévitablement, un jour le prince est amené à voir quelqu’un mourir et à se poser bien des questions auxquelles son éducateur ne sait répondre tout à fait. Une nouvelle étape de son éducation doit commencer et celle-ci est confiée à un prédicateur chrétien appelé Julio. Or voilà que ce personnage permet d’établir un jeu subtil entre la fiction littéraire et la réalité, un jeu qui devra retenir notre attention quand nous analyserons la question de la présence de Juan Manuel dans ses œuvres. En effet, ce prédicateur, appelé Julio, dit venir d’une terre lointaine, la Castille, où il a été l’éducateur du fils de l’Infant Manuel et de la princesse Béatrice, dont le nom n’est autre que ‘Johan’. Bref, l’auteur du livre. L’autobiographie est directement servie par la fiction et va être utilisée tout le long de l’œuvre. Pour ce faire, Juan Manuel met en place un double dédoublement. Le personnage « Juan Manuel » n’est pas uniquement assimilable à celui du récepteur d’un savoir, par exemple ‘Johas’ ‑ qui, ne l’oublions pas, devient, comme par hasard, ‘Johan’ après son baptême chrétien, au ch. 42 ‑ mais est aussi assimilable à celui du dispensateur d’un savoir, c’est-à-dire Julio lui-même (ce qui d’ailleurs met Julio dans la position de Johas). Manifestement, c’est, symboliquement la lettre ‘J’ des prénoms, élément très visiblement commun aux trois prénoms, Julio, Johas et Johan, qui permet tous ces ponts et ces passages (il n’est pas possible de penser à un simple hasard si on constate que cette même structure se retrouve avec les personnages « paternels », avec lesquels c’est le ‘M’ qui est en commun : ‘Manuel’, pour le père biographique et ‘Moraban’ pour le père dans la fiction). Johan et Julio sont donc interchangeables, sont les deux faces du Juan Manuel auteur, ce que l’on retrouvera aussi, on l’a déjà évoqué, avec Lucanor et Patronio. Mais, citons ce texte du Libro de los Estados :
Yo so natural de una tierra que es muy alongada desta vuestra, et aquella
tierra ha nonbre Castiella, et seyendo yo y mas mancebo que agora acaescio que
nascio un fijo a un infante que havia nonbre Manuel et fue su madre doña
Beatriz condesa de Saboya muger del dicho infante et le pusieron nonbre don
Johan et luego que el niño nascio tomele por criado et en mi guarda. Et desque
fue aprendiendo alguna cosa puñe yo en le mostrar et le acostunbrar lo mas et
lo mejor que yo pude. Et desque more con el grant tienpo et entendi que me
podria escusar fui pedricando por las tierras la ley et fe catolica. Et despues
torne a el algunas vezes et sienpre le falle en grandes guerras, a vezes con
grandes omnes de la tierra, et a vezes con el rey de Aragon et a vezes con el
rey de Granada et a vezes con amos. Et agora quando de alla parti estaba en muy
grand guerra con el rey de Castiella que solia ser su señor. Et por las grandes
guerras quel acaescieron et por muchas cosas que vio et que passo, despartiendo
entre el et mi sope yo por el muchas cosas que pertenescen a la cavalleria de
que yo non sabia tanto porque so clerigo et el mio oficio es mas de pedricar
que de usar de cavalleria (ch. 20, p. 99-100).
Le point de départ est apologétique, c’est-à-dire qu’il s’agit de prouver à un païen la supériorité du christianisme sur les deux autres religions monothéistes, Judaïsme et Islam. Pour ce faire, Juan Manuel ne se livre pas à un véritable comparatisme systématique (comme avaient pu le pratiquer d’autres auteurs, comme par exemple Raymond Lulle dans son Livre du gentil et des trois sages). On cherche plutôt à faire état de ce qui serait une « supériorité en soi » du christianisme, à travers l’exposition directe de la doctrine chrétienne. Le prédicateur Julio obtient ainsi une cascade de conversions au christianisme, celle de Johas, de son ancien éducateur Turin et même du roi. Puis, on passe en revue les différents « états » des hommes au sein de la société pour que le jeune prince puisse savoir « dans quel état l’homme peut le mieux sauver son âme ». Tel est la justification, certes bien artificielle, de cette exposition traditionnelle du genre De regimine principum, ou miroir des princes, c’est-à-dire ces textes destinés à l’éducation des princes mais qui offraient, en fait, une vision générale de la société selon l’architectonique du pouvoir. Rien d’étonnant à ce que cette exposition de la société se fasse selon un sens très précis : les différents « états » sont des espèces de cercles concentriques autour de la figure centrale de l’Empereur. Nous avons donc, l’empereur, les rois, la famille des rois, la haute noblesse avec une fonction politique, la moyenne et petite noblesse, les écuyers, les soldats, les titulaires d’offices dans les villes mais surtout au service des grands seigneurs (cette description couvre le livre I, suit le livre II qui, selon la même méthode s’attache aux « états » des religieux). On peut donc penser qu’il s’agit d’une description fortement « ciblée » socialement puisqu’elle s’adresse de toute évidence à un groupe considérablement restreint que l’on peut appeler, pour aller vite, l’aristocratie.
Même si Juan Manuel ne se débarrasse jamais de ce carcan social si intensément marqué (Lucanor est, bien entendu un grand seigneur, avec des soucis qui ne sont que ceux de l’aristocratie), on peut et on doit s’interroger sur l’universalisation du discours littéraire de Juan Manuel dans le Lucanor. C’est peut-être ce que permet le recours systématique à l’exemplum, un exemplum, par définition universalisant, d’ailleurs, qui devient plus important que le simple discours théorique du conseiller destiné, lui, uniquement à son interlocuteur. Et c’est peut-être aussi ce que recherche Juan Manuel lui-même puisque la question est suggérée dès le départ, dans le Prologue, quand il affirme essayer de faire en sorte que le plus grand nombre puisse tirer profit (aprovechar) de son enseignement. Pour revenir à la structure de cette description de la société, Juan Manuel va la chercher sans aucun doute dans la deuxième des Partidas de son oncle Alphonse X, qu’il ne suit certes pas au pied de la lettre puisqu’il ne cesse d’y apporter critiques et amendements, y compris pour la conception de « estado ».
Il y a une continuité manifeste entre le Caballero et le Libro de los estados, qui en est comme l’œuvre prolongée, accomplie, achevée : avec le même système, celui de la fabliella, le Libro de los estados propose l’accomplissement de la pensée politique de Juan Manuel contenue en herbe et de manière beaucoup plus désordonnée dans le Caballero et sans doute dans le Livre de la chevalerie, aujourd’hui perdu, vu ce qu’on en sait. Cette cohérence dans l’œuvre de Juan Manuel est d’autant plus intéressante et révélatrice que la composition du Conde Lucanor suppose, en quelque sorte, une forme de rupture, d’ordre éminemment littéraire, par rapport à ce qui précède.

EL CONDE LUCANOR
Structures et Genres
Quand on s’intéresse au Lucanor on commet souvent l’erreur de ne jamais songer qu’au recueil d’exempla. Tant et si bien que, parfois, on a même réalisé des éditions de l’œuvre qui se contentaient de la première partie, celle des exemples. Or une telle erreur ne fait que poser de manière indirecte la problématique de la structure, de la logique interne du livre de Juan Manuel. Indépendamment de l’antériorité chronologique, incontestable de la première partie, le fait que l’auteur lui-même ait décidé d’adjoindre d’autres parties qui proposent, d’ailleurs, quelque chose de différent, ce fait, dis-je, est suffisamment puissant et riche de sens pour que l’on ne puisse remettre en cause l’unité substantielle de l’œuvre en tant que telle, c’est à dire telle que l’a conçue et voulue son créateur.
Il y a donc une unité structurale du Lucanor et c’est en premier lieu cette unité que nous devons interroger. Bien entendu, unité ne signifie pas uniformité, et voilà sans doute une première distinction à faire au sujet du Lucanor. L’unité de sa composition se trouve dans la mise en évidence d’une diversité de formes. Plus exactement, dans l’exploitation littéraire d’une pluralité de formes qui vont toutes ‑ et c’est là la principale source d’unité ‑ dans le même sens. Des formes diverses, mais un seul objectif créatif. Cet objectif, il suffit de relire le prologue de Juan Manuel pour le déceler. Il s’agit donc d’instruire, de transmettre la sagesse à quiconque voudra la recevoir. Un tel propos n’est autre que celui de mener l’homme vers son salut : son salut ici bas ‑ ce que Juan Manuel appelle, à plusieurs reprises dans ses écrits (par exemple dans le Lucanor mais aussi dans le Libro enfenido), « fallarse ende bien » ‑ mais aussi et surtout son salut dans l’au-delà. Comme dans l’exemple du roi et de l’île (n°49), on ne règne sur terre que pour régner, plus tard, dans les Cieux.
Mais, alors, à quel genre appartient une telle littérature? En fait, nous avons associé deux élans qui ne vont peut-être pas tout à fait ensemble sur le plan générique : instruire, d’un côté, et montrer la voie du salut, de l’autre. Il semble clair que le premier nous met sur la piste de la littérature dite didactique (du verbe grec didaskein, enseigner), alors que le deuxième relève de la littérature morale. Et il est bien vrai qu’on a tendance à confondre ces deux grands genres, voire ces deux « genres de genres » (ils contiennent, en effet, à leur tour des sous-divisions en fonction de thématiques spécifiques), alors qu’en principe ils concernent souvent des domaines et des thématiques fort. Comment faire, alors, pour rendre compte de textes comme celui qui nous occupe? Reste la possibilité d’un concept composé voire composite, celui d’une littérature « didactico-morale », solution qui a été, d’ailleurs, longtemps employée par la critique. De nos jours, on préfère parler de « littérature sapientiale », appellation qui présente l’avantage de mettre d’emblée en évidence la notion de sagesse. Or, à la différence du « savoir » ‑ dans son acception scientifique ‑, la sagesse a ceci de particulier qu’elle se transmet beaucoup plus qu’elle ne s’acquiert. Elle n’est pas le résultat de l’étude mais de la vie, de l’expérience au contact des autres hommes. Elle est donc donnée et reçue. D’où, d’ailleurs, la métaphore que Juan Manuel file dans son prologue. La sagesse est la pilule qui guérit l’homme de son ignorance, et il suffit de trouver les moyens de lui administrer une telle prescription pour le mettre déjà, au moins, sur le chemin de la sagesse – et donc, pense-t-il, du salut.
Mais cette conception de la sagesse est d’autant plus importante qu’elle va façonner le cadre littéraire de ces œuvres dites « sapientiales ». La transmission de la sagesse passe par une mise en scène première : la représentation de la réalité didactique de base, c’est-à-dire, un « être-censé-savoir », dirait la tradition Lacanienne, au contact d’un « être-censé-apprendre », bref, un maître et un élève ou, si l’on préfère, un sage et un disciple. En d’autres termes, la sagesse passe nécessairement par l’enseignement et, donc, c’est une situation d’enseignement que nous montrent la plupart des œuvres relevant de ce genre. D’autant que l’enseignement peut être implicite : il est bien vrai que lorsque l’on choisit de constituer un « recueil de dits de sages », par exemple, on présuppose un enseignement qui a eu effectivement lieu et dont on a retiré la substantifique moelle.
Nous disions que la finalité de cet enseignement est le salut de l’homme dans sa vie terrestre d’une part, et dans la vie éternelle d’autre part. Eh bien, il faut se rendre compte que telle est la portée maximale de la sagesse. Or Juan Manuel, dans ce livre, est tout à fait soucieux d’atteindre de tels paroxysmes, de telles totalités. Il ne veut pas du tout se contenter d’un enseignement ‑ ou d’un type d’enseignement ‑ partiel. C’est pourquoi la diversité de formes dont j’ai parlé a une signification fondamentale : il s’agit pour Juan Manuel de recourir à toutes les formes possibles servant à transmettre la sagesse. Si on met en parallèle les différentes parties qui composent le Lucanor on s’aperçoit qu’elles exploitent à tour de rôle chacune des formes de la littérature sapientiale. Cela nous étonnerait moins s’il s’agissait d’une pratique courante dans ce type de littérature. Or il faut bien voir que le Lucanor est la seule œuvre du moyen âge castillan qui ait cherché à juxtaposer de manière structurée toutes les formes de la littérature sapientiale : c’est la seule à contenir toutes les pratiques discursives du genre didactique. Je tiens à insister sur l’idée d’une juxtaposition structurée, car vous pouvez rencontrer des textes qui superposent sporadiquement formes et discours : un exemplum dans tel recueil peut, en effet, déboucher sur quelques sententiae, etc. Ce n’est pas cela que je veux dire : le Lucanor exploite une forme jusqu’au bout et puis en exploite une autre, d’une manière fort organisée, fort structurée. Et c’est cela qui est unique, ce souci de totalité dans la présentation de l’enseignement moral.
Voilà sans doute aussi la raison qui a poussé Juan Manuel a rajouter des parties. La requête de don Jaime de Jerica (voir le 2e prologue après le ‘livre des exemples’), qui a tout à fait l’apparence traditionnelle et rhétorique du prétexte littéraire (ce qui n’exclut pas le fait qu’elle ait effectivement eu lieu), est surtout, à mon avis, le détonateur d’une nouvelle réflexion de Juan Manuel sur sa création. La demande de don Jaime ne porte que sur l’opposition entre declarado et oscuro, entre claritas et obscuritas, opposition fondamentale dans l’œuvre de Juan Manuel et sur laquelle nous devrons réfléchir. Don Jaime n’indique donc pas les modifications à faire, il se contente de critiquer l’expression, au sens fort (le mode d’expression), choisie par Juan Manuel. Une telle critique est utilisée par l’auteur pour proposer une nouvelle donne. Mais cela ne se fait aucunement en repartant de zéro : il s’agit véritablement d’une progression. La preuve que Juan Manuel a conçu de manière structurale les différentes parties qui composent son livre (à partir du moment où il a décidé de reprendre la plume), se trouve dans la minutie avec laquelle il agence et lubrifie les articulations et les transitions entre les différentes parties. À chaque nouvelle partie, Juan Manuel (pour II) et ensuite Patronio (pour II, III, IV et V) sont là pour justifier une nouvelle prise de parole en insistant bien, et même lourdement, sur le fait qu’il n’y a point de redites mais une nouveauté discursive. On ne revient pas en arrière, on avance. D’ailleurs, tel est aussi le point de vue de Juan Manuel sur la totalité de sa création littéraire : le parallélisme est développé, dans le prologue de II, entre la macro-œuvre manuéline (tous ses textes) et la micro-œuvre (ici le Lucanor), placée sous la responsabilité de Patronio (ce qui explique, d’ailleurs, qu’il soit la voix des prologues suivants). Juan Manuel parle de l’ensemble de son Œuvre (ses œuvres) comme il parle du Lucanor : chaque pièce contient un enseignement spécifique et partiel; si on les additionne on n’aura pas deux fois la même chose mais on obtiendra un enseignement achevé, total. Et cette addition forme un Livre qui est « livre de livres », à l’instar de la Bible dont l’étymologie clame cette pluralité qui est le signe de sa perfection : biblia, est en effet, le pluriel de biblion, livre. Souvenons-nous que Juan Manuel lui-même a cherché à composer le volume de ses biblia. L’une des raisons d’être de ce choix se trouve déjà dans le Lucanor, au prologue de II :
Et bien cuydo que el que leyere este libro et los otros que yo fiz, que
pocas cosas puedan acaescer para las vidas et las faziendas de los omnes, que
non fallen algo en ellos, ca yo non quis poner en este libro nada de lo que es
puesto en los otros, mas qui de todos fiziere un libro, fallarlo ha y mas
complido
« Fallarlo y más complido ». Il apparaît donc clairement que les livres font l’objet d’un enrichissement réciproque, ou plutôt progressif. Cette lecture que nous livre Juan Manuel de sa propre activité créatrice, s’applique bien entendu à la structure même de l’œuvre qui nous occupe. Immédiatement après le texte que nous avons cité, Juan Manuel redonne la parole au « responsable » de la dynamique littéraire du Lucanor, le personnage de Patronio. Et il lui donne la parole pour que ce dernier dise exactement la même chose mais appliquée à l’œuvre qui est en train de se faire sous nos yeux. Que nous dit Patronio? Que, d’une partie à l’autre, la finalité reste la même (Juan Manuel précise à nouveau quelle est cette finalité, un peu plus haut : « fablaré en este libro en las cosas que yo entiendo que los omnes se pueden aprovechar para salvamiento de las almas et aprovechamiento de sus cuerpos et mantenimiento de sus onras et de sus estados », donc les deux pans de la sagesse que j’ai déjà évoqués. Patronio reprend cette double finalité, avec une formule plus ramassée au début du prol. IV : « para salvar el alma et guardar su fazienda et su fama et su onra et su estado »), la finalité, dis-je, reste la même mais la forme change : « et porque se que lo queredes, fablarvos he daqui adelante essa misma manera, mas non por essa manera que en l’otro libro ante deste ». En d’autres termes, on ne répète rien. Cette exigence est formulée de manière encore plus appuyée dans les prologues de III et de IV, qui insistent bien sur le fait que ce qui va suivre n’a pas encore été dit. Par deux fois Patronio précise : « dezirvos he lo que entendiere de lo que aun fata aqui non vos dixe nada » (III) et « yo dezirvos he algo segund lo entendiere de lo que fasta aqui non vos dixe » (IV). Le prologue de III contient même une critique rhétorique de la répétition. On cherche d’autant moins à répéter quelque chose que cette répétition doit être considérée comme un vice : « Ca dezir una razon muchas vegadas, si non es por algun provecho señalado, o paresçe que cuyda el que lo dize que aquel que lo ha de oyr es tan boto que lo non puede entender sin lo oyr muchas vezes, o paresçe que ha sabor de fenchir el libro non sabiendo qué poner en él ». Cette dernière explication est importante. Elle permet aussi de comprendre l’attitude rhétorique des personnages locuteurs dans les œuvres de Juan Manuel. Julio (dans le Libro de los Estados) et Patronio (dans le Lucanor), par exemple, ont, au bout d’un moment, la même gêne à continuer à parler. Ils invoquent certes la fatigue, mais, en réalité, ils répugnent à l’idée de paraître prolixes. Selon les normes de la rhétorique, seul à la demande de l’interlocuteur on peut se passer de la consigne de brevitas. Parler plus que ne l’exige la totale compréhension du discours est une des plus fortes critiques que l’on puisse faire à un orateur. D’où la critique du fenchir, c’est-à-dire ‘gonfler’, ‘remplir d’air, de vide’, le discours. Pour ne pas paraître prolixe, toute nouvelle partie doit être justifiée, ce que, nous l’avons vu, Juan Manuel/Patronio ne cessent de faire.
Encore faut-il donner un sens à cette progression. L’idée que l’on va vers des choses plus subtiles, plus compliquées et donc plus excellentes, plus parfaites est énoncée à chaque fois. D’abord par le passage progressif de la claritas à l’obscuritas, puis, dans la Ve partie, par la décision unilatérale de Patronio de passer à autre chose : « digovos que non quiero fablar ya en este libro de enxiemplos, nin de proverbios, mas fablar he un poco en otra cosa que es muy más provechosa » (je souligne). Cette forme « bien plus profitable », c’est le traité théorique de morale qui clôt notre livre et qui passe pour être la plus élevée de toutes les parties de l’ouvrage, celle qui renferme le message le plus excellent.
Ce dernier texte est fondamental. Il évoque, en fait, à grands traits, la structure générique du Lucanor. Il y est question d’enxiemplos, de proverbios et de cette troisième forme d’expression qui correspond au traité final. C’est dans la juxtaposition de ces trois formes que réside cette visée totalisante dont je parlais, et c’est dans cette même juxtaposition que réside aussi, on l’a dit, le caractère unique de notre œuvre. En effet, il faut savoir que, normalement, chacune de ces formes est traitée séparément. Nous avons donc des recueils d’exempla, des collections de sentences (ou proverbes) et des traités théoriques. Pour s’en convaincre il suffit d’ailleurs de faire état des textes les plus importants du moyen âge qui ont pratiqué chacune de ces formes.
Recueils d’exempla
Commençons par les recueils d’exempla. Mais tout d’abord, qu’est-ce qu’un exemplum? Le terme est fabuleusement polysémique en latin ainsi qu’en français et qu’en castillan médiéval. Il s’agit d’un texte servant à illustrer une idée, mais c’est dans la forme même de ce texte que vient se ranger toute la diversité de cette notion. En effet, il peut s’agir de quelques mots et alors l’exemplum se confond avec le dit, le dicton, le proverbe. Juan Manuel utilise fréquemment le terme enxiemplo dans ce sens dans le L. de los Estados. De même, si le texte est un peu plus long, il sert à établir une identification analogique avec quelque chose qui a été dit (apohtegme) ou qui est arrivé (anecdote) à un personnage historique (tradition des dicta et facta) et ce sur quoi porte le discours du locuteur. Ainsi si l’on parle, par exemple, de la nature lubrique des femmes on pourra présenter un chapelet de cas supposés historiques, mais on pourra en faire autant pour parler de leur vertu. Tel est l’usage le plus répandu des exempla dans l’Antiquité (par exemple, chez Ovide ou Cicéron) et il se développera en Espagne de manière fulgurante avec la fascination pour l’Antiquité qui caractérise le xve siècle, dans certains milieux littéraires On les appellera alors exemplos hystoriales puisqu’ils nous viennent, en quelque sorte, de l’Histoire, dans la mesure où ils concernent des personnages du passé.
Ce type d’exemplum peut avoir une apparence semblable à celle du dernier type, qui est celui qui nous intéresse ici. La grande différence entre l’un et l’autre, c’est que l’exemplo hystorial est censé prouver ou illustrer une idée sans rien provoquer chez l’auditoire, alors que le deuxième doit, en plus, chercher à modifier l’état d’esprit du récepteur. Celui-ci doit être agi par le récit, il doit en être édifié. En d’autres termes, ce dernier type d’exemplum est le plus complexe puisqu’il renferme non seulement une histoire, mais, de plus, un enseignement universellement recevable, une moralité. Il a donc une fonction performative (ou conative) et non pas uniquement illustrative ou apophtegmatique. Bref, ce type d’exemplum agit véritablement sur l’auditeur par un double effet : d’abord parce qu’il permet une meilleure compréhension du temma, l’idée ou le sujet abordés, et ensuite parce que sa forme particulière met en place un principe d’identification susceptible d’entraîner l’adhésion idéologique du récepteur. Pour le distinguer des autres acceptions d’exemplum, certains préfèrent parler d’apologue, mais ce terme (qui désigne un petit récit complètement imaginaire, subjectif, avec une signification morale) est peut-être trop restreint pour satisfaire tous les cas d’espèce qui se présentent dans le Lucanor et que nous allons analyser. Le Diccionario de retórica, crítica y terminología literaria de Marchese et Forradellas (Ariel) donne une définition assez complète de l’exemplum médiéval:
Tipo de relato medieval, en latín o en
lengua vulgar, cercano por su construcción y finalidades a la fábula o el
apólogo. Battaglia lo hace depender del concepto griego de paradeigma,
estudiado por Aristóteles, y especializado en el medioevo en el sentido de un
relato que tiene un valor ejemplar absoluto, de testimonio o prueba válida para
todos los hombres, sin ser en sí mismo ni moral ni inmoral [...]. Welter señala
que el exemplum es «un relato o una historia, una fábula o una parábola,
una moralidad o una descripción que puedan servir de prueba en apoyo de un
discurso doctrinal, religioso o moral [...]. Tenía que contener tres elementos
esenciales: un relato o una descripción, una enseñanza moral o religiosa y una
aplicación de esta última al hombre».
Les exemples du Lucanor sont sans doute plus proches de la définition de Battaglia que de celle de Welter qui part, lui, des manifestations françaises. Il y a donc une spécificité de l’exemplum médiéval hispanique qu’il convient de mettre en lumière.
Il faut distinguer deux traditions et deux types spécifiques d’usage des exempla au moyen âge. La tradition orientale et la tradition homilétique chrétienne. Juan Manuel reçoit de plein fouet l’influence conjointe de ces deux traditions, ce qui constitue en soi un fait assez exceptionnel puisque, jusqu’au xve siècle, la Castille a privilégié, et de loin, une seule tradition, la tradition orientale.
a) La tradition orientale :
Cette tradition est, bien entendu, la plus ancienne. La plupart des textes ont une origine indienne et sont arrivés dans la péninsule Ibérique à travers des traductions arabes. L’histoire littéraire de chacun de ces recueils est souvent complexe puisque les traductions castillanes que nous connaissons sont, généralement, le fruit de plusieurs traditions codicologiques (c’est, par exemple, ce qui se passe avec le Sendebar dont il existe plusieurs branches). Tout d’abord il faut se rendre compte que le caractère littéraire de cette tradition est important. En effet, les recueils ne sont pas de simples compilations juxtaposant différents exempla. On ne se contente pas d’apposer des récits, il faut en plus faire œuvre, ce qui est, assurément un trait caractéristique de l’origine orientale et tout particulièrement indienne. Il faut donc que les différents récits puissent s’emboîter les uns dans les autres dans divers cadres qui finissent par former une architectonique narrative. La diversité des récits n’est acceptable que par l’encadrement que lui procurent les multiples unités dramatiques. Le cas des Mille et une nuits est bien connu. Il trouve son pendant dans le Sendebar où la vie du jeune prince, condamné à mort, est tributaire des divers récits que les uns et les autres présentent au roi. Il faut donc retenir que cette tradition orientale présente la particularité de toujours mettre en scène littérairement les exempla, et c’est bien ce que nous allons trouver chez Juan Manuel. La structure de base pour cette mise en scène est, bien sûr, le dialogue entre deux personnages, le maître et le disciple ou le roi et le conseiller.
La première manifestation hispanique médiévale de cette tradition est l’œuvre du juif converti Pierre Alphonse (Petrus Alphonsi) qui composa en latin sa Disciplina clericalis au début du xiie siècle. Ce sont des dialogues (père/fils, maître/disciple…) dans lesquels apparaissent des récits aux thématiques extrêmement diverses, même si ceux à caractère misogyne sont plus abondants que les autres. Les sources sont aussi très variées : la tradition arabe, mais aussi les Écritures. Dans un certain sens, Petrus Alphonsi fixe le genre et tous ceux qui l’exploiteront ultérieurement, comme Juan Manuel, pourront le prendre pour modèle.
Un siècle plus tard apparaît la première traduction castillane d’un recueil oriental. Il s’agit du Calila e Dimna, dont la traduction fut commandée vers 1250, sous le règne de Ferdinand III, par son fils, le futur Alphonse X. Le point de départ de cette œuvre se trouve dans le Panchatantra (ive s.) écrit en sanskrit. Dans son itinéraire vers l’occident ce recueil reçut l’apport de nombreux exempla relevant de la tradition orale indo-européenne. On peut dire qu’il atteint sa maturité au viiie siècle, moment où il est traduit en arabe. En gros, c’est cette version qui sera traduite dans la Castille du xiiie. Il apparaît que le Calila est un des modèles que Juan Manuel a suivi de plus près. En effet, bien des éléments du recueil ne sont pas sans nous rappeler le Lucanor. À commencer par sa dimension politique. Le dialogue concerne, en effet, un roi et un philosophe. Les exempla sont apportés par le philosophe pour répondre aux demandes de conseil du jeune souverain. Mais ils atteignent un degré surprenant de complexité dans leur imbrication, selon le procédé du « récit à tiroirs » : un personnage raconte un récit dans lequel un autre en raconte un autre, et ainsi de suite. Tant et si bien que plusieurs de ces récits sont des chemins narratifs qui ne mènent nulle part. Il s’agit pour la plupart de fables (exempla animaliers).
Exactement dans le même contexte culturel et politique (l’entourage familial de Ferdinand III), apparaît, en 1253, la traduction du Syntipas (Sendebar, en castillan, appelé aussi Libro de los engaños e assayamientos de las mugeres), commandée par l’infant Frédéric (don Fadrique), frère d’Alphonse. Ce recueil est bien plus court que le précédent mais il offre l’avantage de présenter une structure cadre bien plus riche. Il ne s’agit pas uniquement d’un dialogue, comme dans le Calila et le Lucanor, mais d’une véritable histoire avec une forte charge dramatique, semblable, comme je l’ai évoqué, à celle des Mille et Une Nuits, mais aussi des Contes de Canterbury ou du Décaméron.
Il faut quand même souligner que ces deux traductions trouvent leur origine dans la tête de l’État. On peut donc penser qu’il s’agit d’une démarche politique qui aurait tendance à prouver que les deux textes ont été perçus comme faisant partie de la littérature politique, et plus exactement du genre des miroirs des princes. Il semblerait que le pouvoir se soit approprié cette forme de didactisme d’origine orientale qui, d’ailleurs, véhicule l’idée que se fait le Pouvoir du Sage (le conseiller du roi ou du seigneur) et de la Sagesse (le bon gouvernement de soi par rapport à soi et par rapport aux autres). Il n’est, dès lors, pas invraisemblable de penser que le Lucanor s’inscrit dans cette lignée, selon laquelle l’exemplarité se développe à l’ombre culturelle du pouvoir (alors qu’ailleurs, au même moment il concernera essentiellement la prédication). Voilà, en outre, un nouveau point en commun entre les activités littéraires de Juan Manuel et l’œuvre culturelle de son oncle.
Le troisième texte fondamental de la tradition orientale est le Barlaam e Josaphat, un texte fort ancien (vie s. avant J.C.) qui a été christianisé très tôt, vers les viiie ou ixe siècles. On le retrouve sous cette forme, par exemple, dans la fameuse Légende dorée de Jacques de la Voragine. Ce texte est capital : dans un certain sens, du fait de sa christianisation et sa diffusion latine précoce, il est, véritablement, une des intersections entre les deux traditions de recueils d’exempla. La traduction castillane est de circa 1300.
Les premiers effets de l’énorme succès de ces recueils d’exempla d’origine orientale, traduits surtout sous l’influence de Ferdinand III et d’Alphonse X, sont visibles dans deux œuvres du début du xive siècle directement écrites en Castillan. Il s’agit des Castigos e documentos, qui nous présentent les bons conseils du roi Sanche IV à son fils, le futur Ferdinand IV; et; en outre, le Libro del Caballero Zifar, ouvrage anonyme dans lequel un long passage est constitué par les conseils de Zifar, devenu roi de Menton, à ses deux fils destinés eux-mêmes à régner un jour. Il faudrait ajouter le Libro de buen amor de Juan Ruiz, archiprêtre de Hita (circa 1340) qui recourt volontiers à l’exemplum, mais de manière surtout illustrative et littéraire (trouver argument dans l’illustration pour s’adonner à la maestria de la quaderna via).
b) La tradition occidentale
Je parle de tradition occidentale pour l’opposer à la précédente et parce qu’elle se déploie essentiellement à partir des consignes données par les prédicateurs français. En réalité, il serait plus juste de l’appeler tradition homilétique puisque sa particularité première est de concevoir l’exemplum uniquement comme l’instrument privilégié de la prédication chrétienne. Le point de départ d’une telle idée se trouve sans doute à l’issue des recommandations du IVe Concile de Latran (1215), qui prétendait mener à terme une entière réforme de l’éducation des clercs, mais aussi des fidèles. C’est dans ce contexte qu’est fixée la rhétorique de l’ars praedicandi, l’art de prêcher, grâce à l’impulsion des deux grands théoriciens de l’homilétique, Alain de Lille et Jacques de Vitry. Or l’un et l’autre recommandent instamment l’inclusion d’exempla dans les sermons parce qu’ils stimulent la piété des fidèles et aiguisent l’attention, l’intérêt et la compréhension des laïcs. Cette consigne est reprise et augmentée par les véritables praticiens de la prédication, les membres des ordres mendiants qui se développent au xiiie siècle. Les franciscains et surtout les dominicains, appelés aussi « ordre des frères prêcheurs », vont se charger de composer des recueils d’exempla qui sont, en fait, des alphabeta exemplarum (surtout à partir du xive s.) à l’usage des prédicateurs. De ce fait, les exemples sont, presque toujours démunis de toute mise en scène littéraire. Ils sont abstraits, voire schématiques, une sorte de canevas sur lequel le prédicateur pouvait broder plus ou moins, en fonction de son auditoire ou des circonstances de son prêche. Bref, c’est du matériau non-finitto idéal pour un éventuel développement littéraire : c’est ce que fera Juan Manuel. Manifestement, Juan Manuel connaît la plupart des grands recueils des Dominicains, ordre dont il se sentait très proche (je rappelle que c’est lui qui a fondé le monastère dominicain de Peñafiel). C’est de ces recueils qu’il tire maints exempla du Lucanor. Il s’agit du Tractatus de diversis materiis praedicabilibus, du dominicain Étienne de Bourbon, énorme collection de plus de 3000 exempla; le Speculum laicorum de Jean de Hoveden, le Bonum universale de apibus de Thomas de Cantimpré, le Speculum historiale de Vincent de Beauvais, la Summa praedicantium de l’anglais Bromyard, la Scala coeli et la Scala Dei du provençal d’Alès Jean Gobi junior, les Gesta romanorum, parmi bien d’autres. On ne sait pas grand chose sur la prédication en Castille avant Vincent Ferrier. Son influence dans l’œuvre de Juan Manuel est, de ce fait, doublement intéressante, car cette influence nous prouve que, même si nous n’avons pas gardé de traces écrites de cette prédication, le recueils circulaient bien et l’exemplum était sans doute pratiqué dans le prêche en Castille comme ailleurs.
Les sententiae
Les recueils de sentences sont un genre en rapport avec l’exemplarité mais qui ne se confond nullement avec lui. En effet, il n’y a pour ainsi dire jamais, dans ces recueils, autre chose que des proverbes et des dits de sages, très sommairement introduits par un petit texte, parfois classés, parfois dans le plus grand désordre. Mais les deux genres ont une origine commune, à savoir la tradition orientale qui fait irruption en Espagne à travers la culture arabe. Aussi avons-nous tout d’abord des traductions de l’arabe qui commencent à être réalisées sous Ferdinand III. El libro de los buenos proverbios, traduction de la compilation de Johannicius (Hunain ben Ishaq, médecin du ixe s.), contient 17 chapitres, sans ordre préétabli. La 2e partie est consacrée aux maximes de philosophes connus (Socrate, Platon, Aristote, Alexandre le Grand, Diogène…). C’est à peu près le seul cas où l’on trouve de temps à autre quelques récits exemplaires, de même que figurent des lettres d’Alexandre le Grand qui est sans doute la figure la plus importante du recueil. Les affirmations misogynes sont souvent fréquentes.
Bocados de oro ou El Bonium (qui donne, lu à l’envers « mui noble ») : recueil réuni au siècle précédent par un médecin égyptien. Ce recueil présente la particularité (peut-être due à la traduction) de mettre en scène un récit cadre à l’intérieur duquel se déploient les sentences. C’est l’histoire d’un roi persan, appelé Bonium, qui traverse l’Inde en quête de la sagesse. Il note systématiquement toutes les sentences, les sesos, dirait Juan Manuel qu’il entend au cours de son périple initiatique. Cette œuvre garde un lien très étroit avec la précédente puisque non seulement elle est citée mais même son auteur présumé, Johannicio, l’est.
Libro de los cien capítulos (qui n’en compte que 50), ou Dichos de sabios, de la même époque. Organisé selon un procédé très fréquent à l’époque qui est la division en un nombre de chapitres multiple de 25 (ici 50, mais il prétendait en écrire 100). Songeons au fait que Juan Manuel semble aussi suivre cette coutume avec ses presque 50 exemples, ses 100 proverbes, puis à nouveau 50, etc. Nous y reviendrons.
Vers la fin du xiiie s. apparaissent les Flores de Philosophia qui semblent être une version abrégée du précédent. Là aussi apparaissent quelques exempla épars. La dimension pratique plutôt que sapientiale est clairement marquée dans ce recueil, ce qui nous met sur la voie de la littérature de regimine principum. C’est pourquoi grand nombre de ces conseils se retrouvent au chapitre 3 du Caballero Zifar, parmi les conseils que le roi donne à ses fils. Normalement, les sentences sont attribuées à un auteur de renom, un sage ou grand philosophe. On remarquera alors que la disposition des sentences dans le Lucanor nous laisserait croire que Patronio (donc Juan Manuel) en est l’auteur, puisqu’il n’y a pas d’autre attribution. Or, vous vous en doutez bien il s’agit, pour la plupart d’emprunts. Par conséquent, l’intérêt des sentences du Lucanor ne se trouve pas nécessairement dans leur contenu mais dans leur disposition et leur structure au sein de l’œuvre nous y reviendrons.
Traité théorique
Quant à la troisième forme discrusive du Lucanor, à savoir le traité théorique de la fin, il n’y a pas grand chose à dire, dans le cadre de cette présentation globale : il vient directement de la littérature théologico-morale dans laquelle excellent les auteurs dominicains. Tout ou presque dans ce petit traité final respire l’idéologie dominicaine et, particulièrement, la morale thomiste.